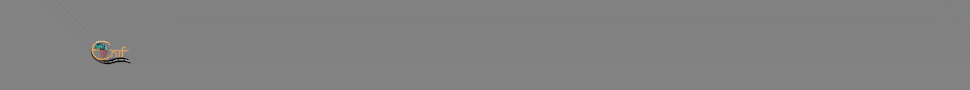Wendlasida Constance KABORÉ, juriste et spécialiste en finances de formation, est une professionnelle dynamique qui combine rigueur juridique et expertise financière. Mais pas que. Aujourd’hui, à travers sa première œuvre littéraire, elle embrasse et entame une carrière d’écrivaine.


« Les sept harmattants » est un recueil très poignant de sept nouvelles, avec de forts référents de la culture africaine et spécialement mossi. L’écrivaine, dans son ouvrage, traite de thèmes de la société africaine comme la sorcellerie, l’âpreté de la vie conjugale, l’infidélité, le Sida, les conséquences de l’aventure, la stérilité, l’individualisme, la frivolité, la vocation, etc.
Dans la présentation du recueil, Wendpayangdé Marcelin KONVOLBO a exposé les grandes lignes qui donnent envie de savourer l’oeuvre.

Comme le suggère son titre, « Les sept harmattans » nous fait traverser sept vents, sept histoires, sept réalités humaines à la fois dures et tendres, tragiques et lumineuses.
Ce recueil de 90 pages offre une plongée saisissante au cœur de la société, de ses contradictions, de ses douleurs, mais aussi de ses joies et espoirs.
La première nouvelle est « Amitié tous risques” (P.9-18). Ce passage démontre que l’amitié se heurte à la jalousie. Labili, fils du chef du village, devient la cible de son propre ami Malobé, par amour pour une fille du village. Il a même signé un accord avec Sogna, un magicien du village, pour tuer Labili. Manipulations, sorcellerie, trahison sont les maîtres-mots qui donnent à cette nouvelle tout son sens.
La deuxième nouvelle est « La Dangerik (455) » (P.19-30). Elle explique l’irresponsabilité parentale et la faiblesse face aux caprices des enfants qui peuvent détruire une famille.
La troisième nouvelle est intitulé « Aissata » (P.31-37). Le personnage principal, doté d’une grande beauté et convoité, tente de séduire un jeune professeur de son école. Suite à l’indifférence de ce dernier, elle décide de surprendre l’enseignant chez lui dans un accoutrement attrayant.
La quatrième nouvelle est intitulé « L’humanitaire ! » (P.39-55). L’essence de cette partie est que le pouvoir de l’argent et les mauvais conseils peuvent faire de nous ce que nous n’avons jamais voulu être. C’est ce que l’on découvre dans cette nouvelle où Bikienga, un gardien au chômage, a fondé une ONG sous les conseils d’un de ses amis d’école, Albert. Bien que réticent au début de la proposition, Bikienga finit par s’y mettre corps et âme et va même jusqu’à détourner des fonds destinés à des malades du Sida.
Pour ce qui est de la cinquième nouvelle « Mon amour, ma traîtresse » (P.57-71), elle relate ceci : Le journaliste d’investigation, Jean Yves BAKOUI enquête sur un trafic d’enfants. Il découvre lors de ses investigations que sa propre femme, Sabine, y est impliquée… et qu’elle lui a caché une stérilité depuis des années, alors qu’ils ont deux enfants ensemble. Des menaces anonymes et la complicité avec la police assimilent cette nouvelle à un film policier. L’auteure, par cette nouvelle, révèle que la trahison peut venir de là où l’on s’y attend le moins.

Dans la sixième nouvelle est titrée « Ma profession » (P.73-81). L’auteure y montre que derrière chaque main tendue, il y a une histoire souvent poignante. Ainsi, un grand-père du nom de Diandoma raconte à son petit-fils Babou la vie dure qu’il a menée comme mendiant pour nourrir sa famille. Malgré le refus catégorique de sa mère, le vieux a perduré dans cette profession, car après plusieurs tentatives d’abandon, il s’est rendu compte que son seul métier, c’est la mendicité.
Enfin, la septième nouvelle est « Silmandé ou le fruit de l’espoir » (P.83-90). Après cinq ans de stérilité, Mado propose à son mari de prendre une seconde épouse, et va même chercher sa cousine pour son mari. Elle élève les enfants de cette dernière avec amour. Et contre toute attente, à 45 ans, elle conçoit un enfant.
Pour l’essentiel, les thèmes abordés – jalousie, hypocrisie, adolescence, parentalité, trahison, mendicité, stérilité, espoir – sont profondément ancrés dans notre réalité burkinabè. Dans un langage simple et accessible à tous, ponctué de dialogues vivants, l’écrivaine explique dans l’imaginaire des réalités de notre société. On y lit les faiblesses, les contradictions, mais aussi le courage, l’amour, et la résilience à l’africaine.
Présente à cette cérémonie, la doyenne de la littérature burkinabè, Bernadette SANOU / DAO, a exprimé sa satisfaction pour l’initiative de Wendlasida Constance KABORÉ à intégrer le monde de la littérature burkinabè. Elle a par ailleurs encouragé et exhorté les jeunes filles du collège notre dame de Kologh-Naaba à travailler pour réussir et devenir des modèles.

Mme DAO a enfin demandé au public de se procurer l’ouvrage pour usage utile.
Le livre est disponible au prix de 4000 F CFA à la Librairie Mercury, sise à la ZAD à Ouagadougou.
Il est possible de se faire livrer des exemplaires en contactant le ( +226) 70 71 57 32 / 78 02 16 08.