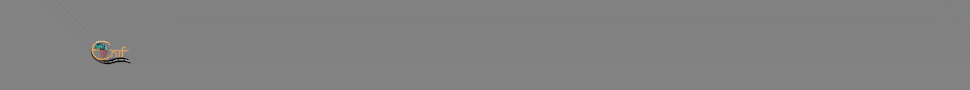Ce jeudi 31 mars 2022, le ministre de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le colonel-major Omer Bationo, a procédé au lancement de deux projets financés par le Fonds Mondial pour l’Engagement de la Communauté et la Résilience (GCERF). L’objectif de ces projets est de prévenir et lutter contre l’extrémisme violent et la radicalisation au Burkina Faso.

« Prévenir la radicalisation et l’extrémisme violent par l’amélioration de la résilience des communautés locales, dans les régions du Sahel et du Nord. », « Tous ensemble, rebâtir une cohésion sociale, à travers la prévention de la radicalisation et la promotion du dialogue intra/intercommunautaire, et la résilience des pasteurs ». Ce sont les deux projets, dont les récipiendaires sont respectivement l’Union Fraternelle des Croyants de Dori (UFC), et le Réseau Afrique Jeunesse (RAJ). « Notre souhait, c’est de contribuer à prévenir la radicalisation, et renforcer la résilience en apportant un appui psycho-social qui est très important. Malheureusement, le plus souvent, on oublie qu’au-delà de s’habiller, de manger, il y a un autre besoin qui est insuffisamment pris en charge. Nous pensons qu’avec les violences, si on ne met pas du prix à apporter aux différentes communautés victimes de l’insécurité, nous allons avoir malheureusement une catégorie de Burkinabè qui n’est pas favorable à notre vivre-ensemble. », à déclaré François Paul Ramdé, coordonnateur de l’UFC-Dori.

D’un coût global de 1.500.000 dollars, ces projets seront exécutés sur une durée de 3 ans, et couvriront les zones du Nord et du Sahel, notamment les provinces du Loroum, du Yatenga, du Séno et du Yagha.

Pour atteindre les objectifs escomptés, L’UFC entend atteindre 49.000 bénéficiaires directs et 100.800 personnes indirects. Il s’agit, entre autres, des leaders coutumiers, des élus locaux, les pasteurs, les personnes déplacées internes, des forces de défenses et de sécurité, des hommes et femmes de médias. Les réalisations attendues sont surtout la mise en place d’un système d’alerte précoce fonctionnel, la mise en place de dialogue, de redevabilité et de concertation entre pasteurs et populations autochtones, l’assistance psycho-sociale des victimes de l’insécurité. « Il y aura des programmes d’accompagnement des jeunes tels que des métiers. Les religieux aussi vont intervenir, et nous sommes pour l’approche collaborative dans tout conflit », a expliqué Daniel Hien, coordonnateur du projet RAJ.
Djamila Kambou